Archives du mot-clé recherche
Nouvelles des membres : Félicitations aux lauréat-e-s du concours de subventions Projet du printemps 2025 du IRSC
Les Instituts de recherche en santé du Canada ont récemment annoncé les résultats de leur concours de subventions Projet du printemps 2025. Au total, 435 subventions ont été accordées dans le cadre des projets du printemps et des projets de priorités. Plusieurs membres du Réseau-1 figurent parmi les lauréat-e-s.
De presque de 800 demandes provenant de Québec, les projets de nos membres représentent 13 des 123 projets financés dans la province. De plus, des 60 demandes en français, 10 ont été financés, dont cinq sont menés par des membres du Réseau-1. Nous félicitons les lauréat-e-s!
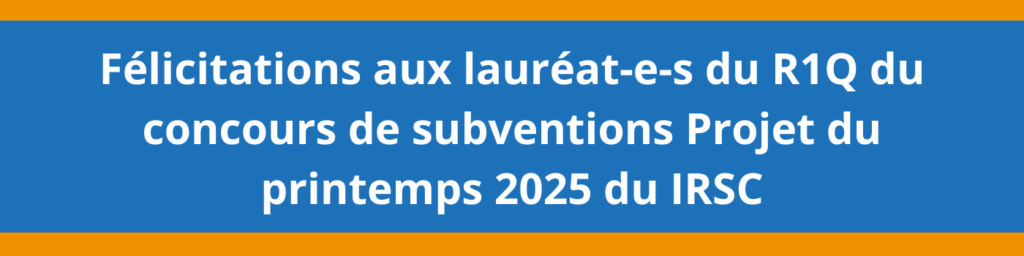
Voici les heureux bénéficiaires :
- Dave Bergeron et son équipe (Université du Québec à Rimouski)
- Projet : « NOUS AVONS LE DROIT DE (BIEN) VIVRE / TENEMOS EL DERECHO DE (BUEN) VIVIR : une recherche participative basée sur les arts pour soutenir la santé holistique des jeunes Autochtones des Amériques »


- Magaly Brodeur et son équipe, dont plusieurs membres du R1Q comme cochercheur-se-s : Isabelle Dufour, Catherine Hudon, Anaïs Lacasse, et Christine Loignon (Université de Sherbrooke)
- Projet : « Les trajectoires de jeux de hasard et d’argent des personnes appartenant à la diversité sexuelle et la pluralité de genre au Canada : Une étude longitudinale mixte »
- Yohann Chiu, Isabelle Dufour et leur équipe (Université de Sherbrooke)
- Projet : « New approaches to care trajectories and treatments for psychotic spectrum disorders: state sequence analyzes and prediction models in a real-world context »





- Isabelle Dufour, Yohann Chiu, Christian Rochefort et leur équipe (Université de Sherbrooke)
- Projet : « Trajectories of care for people living with dementia in Quebec: Improving knowledge using real-world empirical results »

- Claire Godard-Sebillotte, Isabelle Vedel et leur équipe (Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill)
- Projet : « Améliorer l’équité en première ligne pour les personnes avec troubles neurocognitifs majeurs: Une étude à méthodes mixtes axée sur le patient »



- Aude Motulsky et son équipe (Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM))
- Projet : « Valoriser la donnée de vie réelle pour soutenir l’usage optimal du médicament ».
- Gabrielle Page et son équipe, avec Annie-Danielle Grenier (Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM))
- Projet : « Vivre avec une maladie complexe, multisystémique et douloureuse : Cartographier le parcours de vie avec un trouble héréditaire du tissu conjonctif pour développer un parcours d’apprentissage patients »


- Maxime Sasseville, Christian Chabot, Annie LeBlanc et leur équipe (l’Université Laval)
- Projet : « Large-Language Model-Assisted Knowledge Syntheses to Inform Health Policy and Practices »
- Nadia Sourial, Marie-Eve Poitras et leur équipe (Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM))
- Projet : « Share2Care: Who is doing what in interprofessional primary care teams? Measuring performance indicators that reflect and optimize team-based care »



- Tina C Montreuil (Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill)
- Projet : « Paternal Age and the Risks of Adverse Perinatal, Neurodevelopmental and Epigenetic Outcomes in Children »
Deux projets dirigés par des membres du Réseau-1 ont été financés dans le cadre d’annonces de priorités :
Julie Bruneau et son équipe, du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), ont reçu le financement pour son projet, « Advancing HIV and hepatitis C elimination in people who inject drugs ». Il est financé dans le cadre de la Subvention Projet – Annonce de priorité : VIH/sida et ITSS pour une durée d’un an. Cette étude vise à identifier les stratégies les plus efficaces pour éliminer le VIH et l’hépatite C chez les personnes qui s’injectent des drogues, en étudiant particulièrement les différences de genre dans les comportements à risque et les résultats des programmes de prévention et de traitement.
Maude Laberge, de l’Université Laval, et Mylaine Breton ont reçu le financement pour leur projet, « Discontinuité des soins primaires: effets sur l’expérience des patients, l’utilisation et les coûts de santé, et les trajectoires de soins ». Il est financé dans le cadre de l’Annonce de priorité : Recherche axée sur le patient pour une durée de deux ans. Leur équipe compte plusieurs co-chercheurs, incluant Amédé Gogovor, Géraldine Layani, Marie-Eve Poitras, Nadia Sourial. Cette étude cherche à comprendre les impacts de la perte d’un médecin de famille sur l’expérience des patients et l’utilisation des services de santé, particulièrement dans le contexte québécois où il est difficile de trouver un nouveau médecin de famille.



Breaking Barriers: Distributed Analysis for Multi-regional Research
This rexclusive webinar introducing a groundbreaking methodological innovation designed to transform how researchers conduct multi-regional studies, on THURSDAY, JUNE 12 at 10:00 a.m. PT / 1:00 p.m. ET. Traditional data-sharing models often face roadblocks related to privacy and regulatory compliance. Distributed analysis offers a powerful alternative: enabling researchers to analyze data across multiple regions without physically pooling datasets.
In this session, you’ll learn:
- How distributed analysis works and what makes it different from centralized approaches
- Real-world examples where the method has unlocked new collaborative opportunities
- Key benefits for privacy, scalability and regulatory compliance
- Practical guidance on how to get started with the Data Access Support Hub (DASH) at HDRN Canada
Whether you’re conducting multi-regional public health research, managing clinical trials, or collaborating across institutions, this webinar will give you helpful tools to support you with your research.
Who should attend: Researchers, data scientists, epidemiologists, research administrators, and anyone involved in multi-regional research.
CPCRN Learning Series: Meeting the Immediate Needs of Unattached Patients
Toutes les instances font face au défi de relier les personnes à des soins primaires réguliers, et beaucoup de patientes et patients sont inscrits sur des listes d’attente centralisées en attente d’un
médecin de famille. Les soins virtuels et d’autres stratégies complémentaires ont été introduits pour
répondre aux besoins immédiats en soins primaires des patientes et patients isolés, mais ils
s’accompagnent de difficultés pour assurer l’intégration avec d’autres parties du système de
santé et également pour doter ces services d’un personnel qui n’empiète pas sur la capacité des soins primaires de proximité.
Ce panel réunira des scientifiques et des responsables des politiques afin de discuter des
stratégies mises en oeuvre et de tirer les leçons des succès et des difficultés rencontrés. L’objectif est de dégager des enseignements des résultats de la recherche et de l’expérience des politiques menées dans les différentes instances, afin d’améliorer l’accès aux soins pour les patientes et patients orphelins.
Panelists:
Mylaine Breton
(Professor, Dept of Community Health Sciences at the Université de Sherbrooke; Canada Research Chair in Clinical Governance of Primary Care Services; Canadian Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice, 2019-20)
Emily Marshall
(Professor, Dept of Family Medicine, Primary Care Research Unit, Dalhousie University; Director, Strategy for Patient Oriented Research (SPOR) BRIC-Nova Scotia Network; Associate Research Scholar, Healthy Populations Institute)
Kolten McDonald
(Director, Primary Health Care, Family Practice, Chronic Disease Management, and Wellness, Nova Scotia Health Authority; Registered Dietician)
Nouvelles des membres : Félicitations aux lauréat-e-s du concours de subventions Projet du printemps 2024 des IRSC
Plusieurs membres du Réseau-1 figurent parmi les lauréat-e-s du concours de subventions Projet du printemps 2024 des Instituts de recherche en santé du Canada. Au total, 446 subventions ont été accordées dans le cadre des projets du printemps et des projets de priorités.
De plus de 650 demandes provenant de Québec, les projets de nos membres représentent 15 des 109 projets financés dans la province. Des 49 demandes en français, sept ont été fiancés, dont trois sont menés par des membres du Réseau-1.
Nous félicitons les lauréat-e-s!
Quatre projets avec des membres en tant que chercheur-euse-s principaux ont été financés dans le cadre des subventions Projet du printemps 2024 :

Antoine Boivin et Ghislaine Rouly ont reçu financement pour leur projet, « How Peers Influence Healthcare Teams’ Homelessness Prevention and Care Practices: A Participatory Multiple Case Study ». Antoine, chercheur-clinicien, et Ghislaine, patiente partenaire, sont titulaires de la Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et les communautés. Leur projet de recherche participative vise à étudier comment les pairs transforment les pratiques des équipes de santé dans la prévention et les soins pour les personnes sans-abri. Chaque phase de cette recherche sera menée en partenariat avec des pair-e-s, afin de trouver des solutions « avec » les gens plutôt que « pour » eux. Plusieurs co-investigateur-trice-s sont aussi membres : Claudio Del Grande, Vera Granikov, Janie Houle, et Mathieu Isabel.

Le projet « Learning Best Practices from Integrated Care Models for Long COVID » de Simon Décary, Anne Bhéreur, Isabelle Gaboury et Annie LeBlanc a été financé pour quatre ans. Leur projet vise à déterminer les stratégies de soins efficaces dans les cliniques québécoises de soins de Covid longue et à les diffuser à l’échelle nationale. Ces informations aideront les clinicien-ne-s en soins primaires, les patient-e-s et les décideur-euse-s politiques à créer des stratégies d’apprentissage et à les mobiliser dans toutes les régions, en s’alignant sur les lignes directrices nationales en matière de santé. Plusieurs co-investigateur-trice-s sont aussi membres : Patrick Archambault, Marie-France Coutu, Maxime Sasseville, et Yannick Tousignant-Laflamme.

Le projet de Marcel Emond, Axel Benhamed, et leur équipe d’Université Laval, « Redéfinir la neuro-imagerie pour les patients âgés/adultes souffrant de traumatisme crâniocérébral léger », a reçu un financement pour quatre ans. Les patient-e-s âgés de 65 ans et plus souffrent davantage de commotions cérébrales, entraînant plus de visites à l’urgence. Malgré les recommandations actuelles pour des imageries cérébrales, environ 80 % sont normales, remettant en question l’utilisation de ces ressources. Cette étude vise à améliorer la prise de décision pour les médecins à l’urgence concernant la nécessité d’une imagerie de la tête après une commotion cérébrale chez les patient-e-s âgé-e-s. Un co-investigateur est aussi membre : Éric Mercier.
Le projet « CLAIM-Pain-Quality: Validation d’indicateurs de qualité de la gestion de la douleur chronique à l’aide des données administratives de santé » est dirigé par Anaïs Lacasse et son équipe d’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
La douleur chronique représente un défi majeur pour la santé publique, nécessitant des indicateurs de qualité des soins fiables pour évaluer l’efficacité des interventions. Ce projet en trois phases a été conçu pour identifier, opérationnaliser et tester ces indicateurs en utilisant des bases de données gouvernementales d’assurance maladie et des informations autoportées. Ce projet fournira une liste d’indicateurs de qualité valides pour évaluer l’impact des interventions, guider les améliorations futures et orienter les politiques de santé publique. Plusieurs co-investigateurs sont aussi membres : Andréanne Bernier, Yohann M Chiu, Manon Choinière, Isabelle Dufour, Line Guénette, Matthew Menear, Yannick Tousignant-Laflamme et Regina Visca.

Plusieurs membres sont co-investigateur-trice-s sur d’autres subventions Projets du printemps 2024 :
- Marcel Emond et Raoul Daoust sont co-investigateurs sur « Étude MORFÉE : Miser sur le sOmmeil pouR Favoriser la rÉcupération après un traumatismE craniocérébral léger ».
- Machelle Wilchesky est co-investigatrice sur le projet « Recovering from the COVID-19 Pandemic, Informing Future Public Health Crises, and Building a Global Evidence Base for Mental Health Research: A Systematic Review of COVID-19-related Mental Health ».
- Mélanie Couture est co-investigatrice sur le projet « Telemonitoring of activities of daily living in home care services of older adults with cognitive deficits: a large-scale action design research study ».
- Manon Choinière est co-investigatrice sur le projet « Predictors and impact of postoperative pain after same-day surgery – a prospective cohort study ».
- Julie Bruneau est co-investigatrice sur le projet « Establishing the Framework for Decentralized Hepatitis C Point-of-Care Testing and Treatment in Canada: An Implementation Science-based Approach ».
- Benoit Tousignant est co-investigateur sur le projet « Developing a Two-Eyed Seeing approach to vision rehabilitation: A patient-centered, community-oriented initiative for mercury-related visual deficits in Grassy Narrows First Nation ».
- Patricia Li est co-investigatrice sur le projet « Dabigatran for the adjunctive treatment of Staphylococcus aureus bacteremia: the DABI-SNAP nested randomized controlled trial ».
- Pascaline Kengne Talla et Mathieu Roy sont co-investigateur-trice-s sur le projet « Developing inclusive, ethical, and responsible markers for chronic pain conditions ».
Un projet dirigé par un membre du Réseau-1 a été financé dans le cadre d’une annonce de priorités :

Louis Gendron, d’Université de Sherbrooke, a reçu le financement pour son projet, « Mechanisms of opioid tolerance: A role for the delta opioid receptor ». Il est financé dans le cadre de la Subvention Projet – Annonce de priorité : Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite : encéphalomyélite myalgique. Cette étude cherche à comprendre pourquoi les patient-e-s peuvent devenir tolérant-e-s à la morphine et à d’autres médicaments antidouleur similaires au fil du temps, ce qui les obligent à augmenter les doses et peut entraîner des effets secondaires et une accoutumance.
Plusieurs membres sont co-investigateur-trice-s des projets dans le cadre d’une annonce de priorités :
- Justin Sanders est co-investigateur sur le projet « Public, Community & Population Health 2 », Utilization of Psychosocial Oncology Services by Oral Cancer Patients in Montreal Area According to Their Minority Language Profile ». Ce projet est financé dans le cadre de la Subvention Projet – Annonce de priorités : Les communautés de langue officielle en situation minoritaire et la santé.
- Patricia Li et Peter Nugus sont des co-investigateur-trice-s sur le projet « The impact of gender on pediatric surgical care in Africa », financé dans le cadre de la Subvention Projet – Annonce de priorités : Racisme et iniquités raciales dans la recherche en santé tenant compte du sexe et du genre.
Nouvelles des membres : Félicitations aux lauréates du Programme de recherche sur les conséquences sociales de la pandémie
Deux chercheuses du Réseau-1 ont reçu financement dans le cadre de l’Action concertée Programme de recherche sur les conséquences sociales de la pandémie. Ils portent sur les conséquences sociales de la pandémie sur les habitudes de vie des personnes au Québec.
En total, quatre projets ont été financés par le FRQ et son partenaire, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour une période de trois ans. Ces projets vont définir des priorités en santé publique, adapter ou créer des services, ainsi qu’améliorer la compréhension des déterminants sociaux et des inégalités de santé pour promouvoir des habitudes de vie saine et des comportements sécuritaires en matière de santé sexuelle.
Félicitations aux lauréates!

Helen-Maria Vasiliadis, d’Université de Sherbrooke, a été financé pour son projet, « Rôle des inégalités sociales et de santé sur l’évolution de l’activité physique, la sédentarité, et les habitudes alimentaires saines en période de rétablissement postpandémie ».
Lara Maillet, d’École nationale d’administration publique, a été financé pour son projet « Se remettre de la pandémie : miser sur la proximité pour mettre en œuvre des interventions intégrées en santé sexuelle en contexte de vulnérabilité : Recherche action à Montréal-Nord ».

2e Journée annuelle de la Chaire SA3S
À propos de l’événement
Programme préliminaire :
- Rapide retour sur l’année 2023/2024 de la Chaire SA3S
- Présentations et table ronde autour de deux modalités de gestion de proximité en France et au Québec
Panélistes : Isabelle Aubert (Université de Lille, France), Marie-Aline Bloch (EHESP, France), Nancy Desautels (CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Québec) et Lara Maillet (ÉNAP, Québec)
Discutantes : Kadidiatou Kadio (ÉNAP, Québec) et Géraldine Layani (Université de Montréal, Québec)
La question de la proximité et du territoire dans les systèmes de santé et de services sociaux est complexe et revêt plusieurs dimensions. En effet, elle concerne non seulement la gestion des ressources et des services, mais également des enjeux socio-culturels, politiques et économiques. Elle est à la fois une question de gestion et de gouvernance, avec des nuances importantes selon les contextes nationaux. Une comparaison entre la France et le Québec permet de mettre en lumière ces différences et de réfléchir aux meilleures pratiques pour améliorer la prestation des services de santé et sociaux.
- Remise du Prix Paul A. Lamarche 2024 et présentation de l’étudiant.e récipendiaire
- Mot de clôture : Anne Berthinier-Poncet, Maître de conférences en Management de l’Innovation, chercheuse au LIRSA – Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Sciences de l’Action, Conservatoire national des arts et métiers, France
Nouvelles des membres : Les membres les plus cité-e-s dans la recherche en première ligne au Canada
Une étude co-rédigée par plusieurs chercheuses et chercheurs du Réseau canadien de recherche en soins primaires (RCRSP) mesure l’impact des citations et les caractéristiques des publications des chercheurs et chercheuses canadiens dans la recherche en première ligne. L’article démontre le niveau de grande qualité et pertinences des travaux des chercheurs et chercheuses du Canada. Il suggère également que des investissements accrus dans ce domaine pourraient améliorer les politiques et pratiques de soins.
Publié en Médecin de famille canadien (MFC), la revue médicale du Collège des médecins de famille du Canada, Assessing the impact of Canadian primary care research and researchers dresse la liste des 50 chercheurs en soins primaires les plus cité-e-s. Parmi les chercheurs et chercheuses sur la liste, 22% sont basé-e-s au Québec, à l’Université Laval, l’Université McGill et l’Université de Sherbrooke.
Plusieurs membres du Réseau-1 ont une place dans cette liste. Nous sommes fiers de nos membres et tous leurs travails pour améliorer et innover la première ligne!


Les chercheurs et chercheuses membres du R1Q les plus cité-e-s au Canada :
- France Légaré est au troisième rang, étant citée plus que 18 400 fois. En tant que première auteur, elle a publié 71 articles évalués par des pairs, et en tant que co-auteur, elle a publié plus que 350.
- Martin Fortin est en quatrième position avec 7 100 citations. En tant que premier auteur, il a publié 30 articles évalués par des pairs, et en tant que co-auteur, il a publié plus que 100.
- Jeannie Haggerty, la directrice fondatrice du R1Q, est la 13e chercheuse la plus citée au Canada. En tant que première auteur, elle a publié 29 articles évalués par des pairs, et en tant que co-auteur, elle a publié plus que 100. En total, elle a été citée plus que 4 300 fois.
- Pierre Pluye, un membre fondateur du R1Q, est au 16e rang avec 7 500 citations, comptant 33 articles en tant que premier auteur et plus de 100 en tant que co-auteur.
- Howard Bergman est le 28e chercheur le plus cité avec 13 articles comme premier auteur. Il a publié plus que 200 en tant que co-auteur et au total il a été cité plus que 18 700 fois.
- Neil Andersson est le 41e chercheur le plus cité. En tant que premier auteur, il a publié 56 articles évalués par des pairs, et en tant que co-auteur, il a publié plus que 160. Au total, il a été cité presque 6 000 fois.
- Richard Fleet est au 49e rang le plus cité au Canada avec 1 500 citations au total. En tant que premier auteur, il a publié 33 articles évalués par des pairs, et en tant que co-auteur, il a publié plus que 50.

Parmi les articles les plus cités des chercheurs canadiens en soins primaires, évalué par des pairs, nous retrouvons plusieurs publications des membres du R1Q :
- L’article du Jeannie Haggerty, « Continuity of care: a multidisciplinary review », est le 7e article le plus cité.
- L’article du Howard Bergman, « Frailty: an emerging research and clinical paradigm—issues and controversies », se retrouve en 13e position.
- L’article du France Légaré, « Barriers and facilitators to implementing shared decision-making in clinical practice: update of a systematic review of health professionals’ perceptions », est au 15e rang.
- Deux articles du Pierre Pluye figurent dans les articles les plus cités des chercheurs canadiens en soins primaires, évalués par des pairs. Son article en collaboration avec Quan Nha Hong « Combining the power of stories and the power of numbers: mixed methods research and mixed studies reviews » est le 21e article le plus cité. Une collaboration avec Marie-Pierre Gagnon, « A scoring system for appraising mixed methods research, and concomitantly appraising qualitative, quantitative and mixed methods primary studies in mixed studies reviews » se place en 22e position.
- Trois articles du Martin Fortin figurent dans les articles les plus cités des chercheurs canadiens en soins primaires, évalués par des pairs. Son article, rédigé en collaboration avec Catherine Hudon, « Prevalence of multimorbidity among adults seen in family practice » est le 20e article le plus cité. L’article en collaboration avec Marie-Ève Poitras « A systematic review of prevalence studies on multimorbidity: toward a more uniform methodology » est le 23e article le plus cité. Un troisième article, en collaboration avec Catherine Hudon, « Multimorbidity and quality of life in primary care: a systematic review » retrouve le rang du 25e article le plus cité.
Bilan d’une carrière accompli : Un mot de remerciement et réflexion avec Dre Jeannie Haggerty
Dre Jeannie Haggerty est professeure titulaire au département de médecine familiale de l’université McGill, et titulaire de la chaire de recherche McGill en médecine familiale et communautaire, basée au centre de recherche de l’hôpital St Mary. Elle a été la directrice scientifique fondatrice du Réseau-1 Québec et la directrice du RRAPPL de McGill.
Après une longue carrière en recherche sur les soins primaires, elle amorce un retrait progressif pour prendre sa retraite à l’été 2025. Nous avons discuté de sa carrière et de son rôle indispensable au Réseau-1.

- Parlez-moi un peu de votre carrière et de la place du Réseau-1 dans celle-ci.
Formée en épidémiologie, j’ai eu mon baptême en médecine de famille comme coordonnatrice d’un projet du Département de Médecine familiale de l’Université McGill pour établir un nouveau programme de résidence en Médecine familiale et communautaire au Costa Rica. J’ai toujours été très attirée par l’idée de créer un réseau de recherche basé sur la pratique.
Ma recherche porte sur l’accessibilité et la continuité des soins en première ligne. Ma carrière académique a commencé à l’Université de Montréal en médecine familiale et par la suite à l’Université de Sherbrooke où j’ai été titulaire d’une chaire de recherche du Canada avant que McGill me propose une chaire de recherche en médecine familiale et communautaire à Saint-Mary—là où la médecine familiale a commencé pour moi.
Depuis environ 2011, les chercheurs en médecine familiale songeaient à un réseau de recherche en soins de première ligne pour nous permettre de collaborer davantage. Bien que nous ayons commencé avec des plans modestes, il y avait un fort intérêt de la part du ministère de la Santé et des services sociaux à combiner notre initiative avec la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) provincial. On a visé un réseau de connaissances pour réduire l’écart entre la recherche et la pratique.
Un groupe de 25 à 30 personnes se réunissait presque toutes les deux semaines pendant des mois pour définir le pourquoi et le comment de notre réseau. Nous avons donc obtenu un financement pour devenir un réseau thématique du FRQS, en juillet 2013.
Pour bâtir le réseau, nous avons développé et fédéré des réseaux de recherche axée sur les pratiques de la première ligne (RRAPPL) dans tous les départements de médecine familiale et médecine d’urgence du Québec. Dès le début, nous avons planifié que R1Q soit un réseau de connaissances qui réduise l’écart entre la recherche et la pratique.
- Quel défi avez-vous rencontré en tant que directrice du Réseau-1?
Le plus grand défi était de tout commencer de zéro. Nous n’avions aucune structure. Nous avons donc dû créer la structure de gouvernance et la charte et embaucher de nouvelles personnes. C’était une entreprise énorme. Nous avions tant à construire. J’ai suivi des cours sur la gouvernance et j’ai essayé d’appliquer les meilleures pratiques. C’était une courbe d’apprentissage très rapide.
- Quelle a été une réussite?
Une de notre plus grande réussite a été de défendre le rôle des patients partenaires dès le début. Les patients partenaires ont toujours eu une place d’influence à chaque niveau de notre réseau. Le SRAP a représenté un grand changement culturel pour la recherche et nous étions en avance de cette vague. Ce n’était pas toujours facile, mais cela nous a permis d’effectuer ce travail de manière très significative.
- Comment avez-vous changé ou influencé Réseau-1?
Je dirais que tout le travail initial pour construire le réseau et ses structures, telles que la gouvernance et la charte, a été accompli. Il y a bien sûr eu des changements au fil des ans, mais ces structures sont restées assez stables.
- Avez-vous été surpris par quelque chose de Réseau-1?
Oui, l’image de marque du Réseau-1. Nous avons commencé par organiser un concours pour trouver un nom du réseau et nous avons reçu des propositions très drôles et très longues qui n’ont pas fonctionné. Puis nous avons choisi Réseau-1 et c’est resté depuis 10 ans. C’est une bonne surprise.
- Surtout, que ferez-vous maintenant avec tout votre temps libre?
En ce moment, je m’intéresse beaucoup à l’entrepreneuriat social. J’explore la possibilité de transformer l’un de mes derniers projets de recherche en un modèle d’entrepreneuriat social pour améliorer l’accès et la continuité des soins.
Dre Haggerty a joué un rôle indispensable à notre développement et a grandement contribué à notre succès. Nous la remercions pour son travail au sein du RRAPPL de McGill et du Réseau-1. Dre Machelle Wilchesky remplacera Dre Haggerty en juillet 2024 comme directrice du RRAPPL de McGill.
Décloisonner les savoirs : la recherche communautaire LGBTQ
Dans les imaginaires collectifs, les savoirs dits « scientifiques » proviennent exclusivement des universités. Pourtant, des organisations de la société civile réalisent elles-mêmes des recherches qui répondent entre autres à des besoins de (re)connaissance de réalités marginalisées ou en situation d’exclusion. C’est le cas des organismes communautaires voués à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres, qui mettent en lumière les enjeux vécus par les populations lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queer (LGBTQ) et participent activement à la construction des savoirs qui les concernent.
L’objectif de cette table ronde est de réunir des représentant·es d’organismes LGBTQ ayant investi le champ de la recherche communautaire au Québec, pour discuter :
- Du contenu de leurs travaux (faits saillants) et de l’évolution des types de recherches développées;
- Des enjeux méthodologiques et éthiques rencontrés dans les processus de recherche (proximité avec les personnes et les communautés concernées, place du bénévolat dans un tel contexte, reddition de comptes avec les bailleurs de fonds, visées de la recherche, revendications politiques, etc.)
- Des défis entourant la crédibilité, la diffusion et le rayonnement des connaissances produites hors des murs universitaires.
Animation et organisation de l’événement :
Kévin Lavoie, Alain Arsenault et Olivier Vallerand, membres du champ Diversité sexuelle et pluralité des genres du CREMIS.
Panélistes :
Tara Chanady est directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec (RLQ). Elle détient un doctorat en communication et un postdoctorat en santé publique de l’Université de Montréal. Ses expertises incluent les enjeux identitaires, géo-spatiaux et la santé mentale des femmes de la diversité sexuelle et des personnes lesbos-queer. Pour connaitre les recherches réalisées par le RLQ, cliquez ici.
Engagé·e dans les luttes queers et trans depuis près de dix ans, Loïs Crémier travaille actuellement au Conseil québécois LGBT. Titulaire d’un doctorat en sémiologie, ses intérêts de recherche sont la métaphore, l’utopie, les dispositifs d’énonciation collective et la circulation des signes du sexe/genre en contexte francophone nord-américain. Pour connaitre les travaux de recherche du Conseil québécois LGBTQ, cliquez ici.
Amélie Charbonneau est chargée de recherche pour le GRIS-Montréal depuis 2013. Forte de ses études en travail social, en études féministes ainsi qu’en communications, elle aime particulièrement documenter les perceptions et les représentations des jeunes sur les personnes de la diversité sexuelle et de genre.
Aimé Cloutier est assistant de recherche pour le GRIS-Montréal depuis le printemps 2022. Sociologue et éducateur de formation, il s’intéresse particulièrement aux rapports sociaux de genre, aux représentations sociales des personnes trans, aux conditions de solidarité intra-groupe ainsi qu’aux épistémologies engagées. Pour connaitre les recherches menées par le GRIS, cliquez ici.






